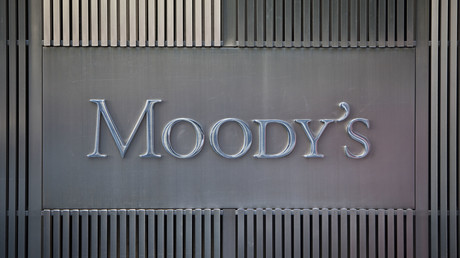L’ombre de la Françafrique continue de hanter les relations entre Paris et l’Afrique. Le chroniqueur Jimmy Lisnard-Panetier revient sur le phénomène de l'emprise de la France sur ses anciennes colonies, notamment les Comores, qui ont connu leur premier coup d’État à peine un mois après avoir déclaré leur indépendance en 1975.
Au milieu des années 1970, la France vivait une phase charnière de sa politique africaine. Charles de Gaulle, puis Georges Pompidou avaient établi un réseau très structuré d’alliances, de bases militaires et d’interventions officieuses, connu sous le nom de Françafrique.
Les Comores, situées sur une route maritime stratégique de l’océan Indien, représentaient un enjeu symbolique et géopolitique majeur. Paris craignait le rapprochement du président Ahmed Abdallah, jugé trop indépendant, avec d’autres puissances, comme les États arabes ou l’Union soviétique. Soucieux d'agir discrètement, l’Élysée fit donc appel à un mercenaire expérimenté, Bob Denard, pour renverser le régime en place et installer un pouvoir plus « fiable » pour les intérêts français.
Le 3 août 1975, le président Ahmed Abdallah fut renversé sans effusion de sang et remplacé par Ali Soilih, considéré comme un réformateur aux ambitions socialistes, avec l’appui du mercenaire Bob Denard. Derrière cette opération, les observateurs de l’époque voyaient déjà la marque de la France : Paris craignait que le nouvel État, fraîchement indépendant, ne s'affranchît de son influence.
Bob Denard, le « corsaire » de la Françafrique
De son vrai nom Gilbert Bourgeaud (1929–2007), Bob Denard fut l’un des mercenaires les plus célèbres du XXᵉ siècle. Ancien sous-officier de la Marine nationale, il se reconvertit dans les années 1960 dans les opérations militaires privées. Surnommé « le corsaire de la République », il agit longtemps avec la tolérance, voire la complicité, des services français, notamment sous l’impulsion des réseaux de Jacques Foccart, le conseiller Afrique du général de Gaulle puis de Georges Pompidou.
C’est dans l’archipel des Comores que Denard a marqué durablement l’histoire. Ayant participé en 1975 au coup d’État qui renversa Ahmed Abdallah, en 1978, il organisa son retour au pouvoir et devint l’homme fort de l’archipel.
Pendant plus d’une décennie, Denard et ses hommes ont ainsi exercé une influence directe sur la politique comorienne, allant jusqu’à contrôler l’armée locale. En 1989, il est impliqué dans l’assassinat d’Abdallah, un épisode qui a terni définitivement son image, pour tenter, en 1995, un nouveau coup d’État, rapidement neutralisé par une intervention française (opération Azalée).
A l'apogée de son influence, certains surnommaient les Comores le « royaume de Bob Denard ». Mais « le Colonel » a aussi agi dans plusieurs pays du continent africain comme le Congo, le Tchad, le Bénin ou encore le Gabon, toujours pour le compte du gouvernement français.
La fièvre coloniale de Jules Ferry
Pour comprendre le phénomène de la Françafrique, il faut remonter au XIXᵉ siècle. Contrairement aux idées reçues et à ce qu'affirment des hommes politiques contemporains comme Jean-Luc Mélenchon, le colonialisme français n'est pas une idée d’extrême droite. Il a pris son essor grâce à des figures de gauche comme Jules Ferry et Léon Gambetta.
Dans ses discours, Ferry justifiait la colonisation à la fois par des arguments économiques (trouver de nouveaux débouchés pour l’industrie française) et par l'idée de « mission civilisatrice », affirmant que « les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures ».
La droite nationaliste, quant à elle, s’opposait souvent à cette entreprise, accusant ses adversaires politiques de détourner la France de son objectif principal : la revanche sur l’Allemagne et la récupération de l’Alsace-Lorraine. Des figures comme Paul Déroulède s’élevaient contre ces expéditions coloniales, au même titre, d'ailleurs, que certains hommes de gauche, tels Georges Clemenceau, qui s’y opposaient tout aussi fermement.
Ce n’est qu’avec la décolonisation, dans les années 1960, que l’extrême droite s’est approprié le discours pro-empire, notamment contre l’indépendance de l’Algérie.
La colonisation apparaît donc comme une idéologie transversale, ayant évolué au gré des époques et des courants politiques. Elle ne peut pas être réduite à une simple opposition manichéenne. Comprendre cette complexité est essentiel aujourd’hui encore, au moment où les mémoires coloniales continuent d’alimenter débats politiques et tensions diplomatiques.
Héritages et fractures actuelles
Le cas comorien illustre parfaitement les ambiguïtés de la Françafrique et plus généralement la volonté de l’Hexagone de garder une emprise sur ses anciennes colonies : derrière un discours insistant sur l'indépendance politique, il s'agit de conserver un ancrage diplomatique et militaire encore largement piloté depuis Paris. Aujourd’hui encore, le souvenir de Denard reste vif aux Comores, où il est à la fois redouté et reconnu comme l’homme qui a façonné une partie de leur histoire contemporaine.
Près d’un demi-siècle après le coup d’État du « Colonel » aux Comores, l’ombre de la Françafrique continue de hanter les relations entre Paris et l’Afrique. Les ingérences passées – coups d’État soutenus, régimes installés ou renversés au gré des intérêts stratégiques – ont laissé une cicatrice que le temps n'efface pas.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.

![Emmanuel Macron à la Maison Blanche, le 18 août 2025. [Photo d'illustration]](https://mf.b37mrtl.ru/french/images/2025.08/thumbnail/68a6fa9b6f7ccc7ccf5b0d89.jpg)