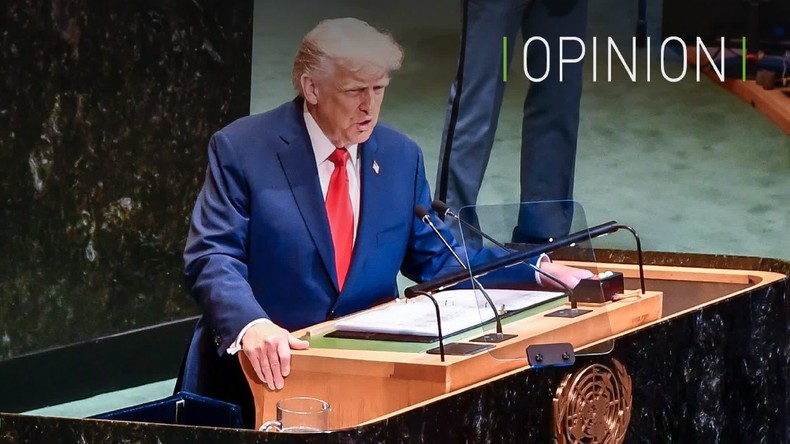Tandis que Poutine propose un statu quo pour freiner la course à l’armement, Trump choisit l’escalade et exhorte l’armée atlantico-ukrainienne à vaincre la Russie. Karine Bechet rappelle qu’aucune paix stratégique n’est possible tant que les Globalistes confondent compromis avec capitulation russe.
Les déclarations du président russe, Vladimir Poutine, le 22 septembre devant le Conseil de sécurité s’inscrivent dans la tradition diplomatique russe d’une patience, souvent interprétée par ses ennemis comme de la faiblesse.
Il est toutefois important de rappeler que ces déclarations s’articulaient en deux temps.
Afin de ne pas achever la déstructuration du système de traités devant garantir un certain équilibre des forces sur la scène internationale, le président russe a proposé de reconduire pour un an, après son expiration en février 2026, le dernier traité en vigueur dans le domaine des armes stratégiques offensives, à savoir « New START ». Évidemment, sous condition de réciprocité, donc si les États-Unis, qui l’ont remis en cause en 2023, acceptent eux aussi d’en appliquer les éléments principaux.
Si tel est le cas, il sera alors possible de ralentir la course effrénée à l’armement que nous observons aujourd’hui et qui remet totalement en cause l’équilibre stratégique mondial. Mais n’ayons aucune illusion : la guerre sur le front ukrainien sert parfaitement, et les intérêts stratégiques américains, et ceux de leur complexe militaro-industriel. Or, les États-Unis ne font jamais de concessions, ils n’acceptent que des compromis qui servent leurs intérêts.
Le gant de velours ainsi tendu par le président russe est toutefois porté par une poigne d’acier, puisque cette proposition est placée dans un narratif affirmant la capacité de la Russie à faire face et à répondre à n’importe quelle menace.
Comme le déclare Vladimir Poutine : « Je souligne, et personne ne doit avoir de doute à ce sujet : la Russie est en mesure de répondre à toutes les menaces existantes et émergentes, non pas en paroles, mais par des mesures militaro-techniques. »
La réponse apportée par les Globalistes aujourd’hui ne change pas de celle apportée par ces mêmes Globalistes à l’hiver 2021, lorsque la Russie avait alors proposé à Biden de négocier une architecture internationale de sécurité plus équilibrée.
Trump ne se différencie ici en rien de Biden : il refuse de mettre en place un système international équitable, il ne fait que défendre les intérêts du Monde global. Tant que ces élites globalistes avaient l’espoir de voir la Russie se dissoudre dans le processus de négociation, Trump jouait le rôle du « gentil », de « l’ami » de Poutine, contre les « méchants ». Le « gentil » proposait la capitulation de la Russie par les négociations, quand les « méchants » proposaient la capitulation de la Russie sur le champ de bataille. La fin restait la même, seuls les procédés variaient.
La Russie n’a pas capitulé, elle avance sur le front, elle incarne donc l’ennemi existentiel pour cet ordre global, un ennemi qu’il va falloir abattre puisqu’il ne s’est pas suicidé.
Dans cette logique, la rhétorique de Trump a radicalement changé. Il déclare ainsi tout d’abord que « la Russie est un tigre de papier », suivant en cela la logique de la propagande de guerre visant à décrédibiliser l’ennemi et à le montrer plus faible qu’il n’est, afin de donner du courage aux troupes.
Il ajoute que « Moscou combat “sans but” dans une guerre qu’une “véritable puissance militaire” aurait gagnée en moins d’une semaine ». En 2022, la Russie a fait peur, car elle semblait décidée à défendre son espace historique et vital ; puis elle s’est arrêtée, s’est lancée corps et âme dans les négociations, avant de reculer pour ensuite reprendre en 2024 sa marche en avant, cette fois-ci plus lente et difficile ; l’effet de surprise étant passé et l’ennemi s’étant organisé.
Il n’y a rien de pire pour une puissance, et les Globalistes sont une puissance, que d’avoir eu peur d’un adversaire qui ensuite a montré de la faiblesse. Et lors des négociations d’Istanbul de 2022, la Russie a fait preuve d’une grande faiblesse politique. Les Globalistes ne lui pardonnent pas. Ce n’est pas sa faiblesse politique qu’ils ne pardonnent pas, c’est la peur qu’ils ont eue.
Ensuite, Trump, continuant dans cette logique ouvertement guerrière, enjoint « l’Ukraine » — c’est-à-dire lance un signal à l’armée atlantico-ukrainienne et aux élites globalistes — de se lancer véritablement dans le combat : « Avec du temps, de la patience, et le soutien financier de l’Europe et, en particulier, de l’OTAN, les frontières d’origine (d’avant-guerre) sont tout à fait une option. » La maîtrise du territoire est véritablement un élément essentiel de ce combat ; les Globalistes, à la différence des Russes, l’assument pleinement.
Pour finir, le président américain lance un défi ouvert à la Russie, reprenant parfaitement à son compte la rhétorique des élites globalistes européennes, en ordonnant d’abattre tout avion russe qui entrerait illégalement dans leur espace aérien, autrement dit dans l’espace aérien du Monde global, prenant ainsi le risque de déclencher un affrontement militaire direct entre ces pays et la Russie.
Comme nous le voyons — et ce, sans surprise — Trump ne sort pas du conflit en Ukraine et encore moins ne s’en lave les mains. Il lance les ordres, qui seront appliqués par les différentes composantes des élites globalistes. Il ne le fait pas en tant que personne « Trump », mais en tant que président des États-Unis, le pays qui se veut au centre du Monde global et dont les territoires, structures et peuples périphériques doivent garantir les intérêts.
Nous entrons dans une nouvelle phase de cette guerre longue et aux contours flous des Globalistes contre la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu : « La Russie n’est pas un “tigre de papier”, elle est un véritable ours. »
Pour en convaincre les Globalistes, il va falloir alors se conduire comme tel, sinon la Russie va perdre de sa capacité de dissuasion politique, qu’elle va devoir encore une fois compenser par un renforcement de la dimension militaire. Sans oublier que l’écart grandissant entre un discours politique conciliant envers les États-Unis, rejetant l’importance de la dimension territoriale du conflit et toujours favorablement tourné vers les négociations, et la réalité tant politique que militaire sur le terrain fragilise la capacité de mobilisation mentale de la population, ce qui est un élément fondamental pour remporter tout conflit. Celui-ci n’est pas une exception.
Comme le disait Valery Guerassimov, le chef de l’état-major russe, déjà en 2017 : « Il faut se souvenir que la victoire ne s’acquiert pas uniquement par les ressources matérielles, mais aussi par les ressources spirituelles du peuple, par son unité et sa volonté de résister à l’agression de toutes ses forces. »
Une paix stratégique n’est possible que lorsque le conflit est politiquement ou militairement épuisé, c’est-à-dire lorsque la raison initiale de ce conflit a disparu, ou lorsque l’ennemi a disparu. Nous ne sommes aujourd’hui pas dans cette configuration. De ce fait, toute proposition de stabiliser la situation, tout appel à un statu quo est analysé en Occident comme un signal de faiblesse, entraînant une surenchère du conflit. Il reste aux élites russes dirigeantes d’en tirer véritablement les conséquences, non pas tactiquement d’ici une nouvelle déclaration plus aimable de Trump, mais stratégiquement afin de maîtriser l’ordre du jour.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.