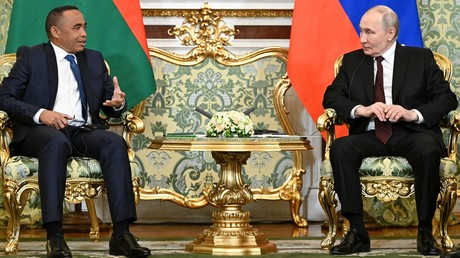«Le plus grand incendie depuis des décennies» : pour Bayrou et Pannier-Runacher, c’est la faute au réchauffement climatique. L’incendie du massif des Corbières offre à Alexandre Regnaud l’occasion de revenir sur les véritables causes des «mégafeux» estivaux.
Le cirque médiatique a battu son plein au moment de l’incendie du massif des Corbières, dans l’Aude, début août, avant de céder la place à un autre avec l’arrivée d’une nouvelle vague de chaleur. Les deux se sont enchaînés à merveille avec un seul et même responsable désigné : le réchauffement climatique. Si nous avons déjà analysé les manipulations autour de la canicule, il faut également faire très largement la part des choses concernant les incendies et feux de forêt.
« Le plus grand incendie depuis 1949 », nous dit la ministre de la « Transition écologique ». Ce qui veut donc dire qu’il y en avait déjà… en 1949. Plus sérieusement, les feux de forêt estivaux sont un phénomène récurrent et frappent la France, systématiquement, tous les étés.
Cependant, on note une aggravation ces quatre dernières années, avec six évènements majeurs, ce que l’on appelle les « mégafeux », plus destructeurs qu’à l’ordinaire (supérieurs à 5 000 ha), pour 18 en tout enregistrés depuis le début des relevés en 1973. Alors ? Réchauffement climatique ? Bien sûr que non !
Un rapport du Sénat de 2023 indique que 90 % des départs de feu sont liés à des activités humaines : imprudence, bien sûr, mais avant tout… pyromanie. C’est-à-dire criminalité. Rien à voir donc avec le climat. Mais cela n’est pas nouveau non plus et n’explique pas la multiplication des « mégafeux ».
Il faut, comme toujours, plutôt aller fouiller du côté des décisions politiques. On va alors trouver la combinaison de trois facteurs.
Tout d’abord, l’habituelle mauvaise gestion économique du gouvernement et, comme toujours, la question de savoir où passe l’argent des impôts pourtant confiscatoires.
En effet, la suppression, ces dernières années, de 500 postes à l'Office national des forêts (ONF) a entraîné un désengagement dans la Protection de la forêt méditerranéenne (PFM) et la Défense des forêts contre l'incendie (DFCI). Dans la même veine, pour le « mégafeu » de l’Aude, seulement quatre Canadairs étaient mobilisés sur une flotte de douze appareils, tous les autres étant hors service. Des commandes ont été promises, mais pas avant au moins 2033, faute de budget. Pourtant, l’aide militaire versée par la France à l’Ukraine en 2025 aurait permis à elle seule de financer 36 appareils neufs. Une question de priorité, sans doute.
Ensuite, la loi du 10 juillet 2023 a rejeté la création d'un crédit d'impôt pour les travaux de débroussaillement obligatoire (Obligation légale de débroussaillement). Cela limite l'adhésion des propriétaires privés, alors que 75 % des forêts françaises sont… privées.
La même loi transfère aux EPCI (les intercommunalités) la compétence « défense extérieure contre l'incendie », mais sans doter les communes de moyens financiers ou techniques pour appliquer les OLD.
Ces différents désengagements de l’État favorisent l’inaction, avec un taux d'application des OLD inférieur à 30 %, d’après le Sénat, et donc l'accumulation des broussailles (buissons, herbes sèches, etc.), c’est-à-dire de biomasse combustible. Autrement dit, le principal vecteur naturel de propagation des incendies.
On en arrive alors au second facteur, et l’on retrouve les fameuses politiques d’« escrologie ». C’est-à-dire des décisions politiques prises au nom de la protection de l’environnement, mais responsables en réalité de sa dégradation.
Ainsi, les politiques de protection de la biodiversité limitent le débroussaillement mécanique dans les aires protégées (28 % du territoire), créant des continuités de végétation inflammable.
En parallèle, la méthode du brûlis dirigé est interdite, classée comme « polluante ». C’est pourtant un outil historique de réduction du combustible ; son interdiction, dans le cadre des politiques environnementales, augmente encore le stock de biomasse sèche.
Et finalement, la raréfaction des activités agricoles sous les coups de Bruxelles, la baisse des subventions européennes pour le pastoralisme et l'absence de compensation pour les travaux nocturnes en période à risque privent la nature d’un moyen traditionnel de créer des coupures de combustible naturelles.
Troisième facteur, enfin, une urbanisation non maîtrisée — une réflexion que l’on retrouve d’ailleurs à l’identique s’agissant des inondations.
Si les feux de forêt touchent de plus en plus souvent les habitations, c’est tout simplement dû à une urbanisation croissante des zones à risque (90 départements touchés en 2022).
La loi de 2023 ne résout pas la question de la densification des constructions en lisière de forêt, multipliant d’autant les zones à risque de départ de feu et les risques d’embrasement d’habitations en cas d’incendie. Une erreur réitérée dans la nouvelle stratégie nationale (juin 2025), qui impose une carte des zones à risque révisée tous les cinq ans, mais ne s'accompagne pas de restrictions urbanistiques contraignantes, laissant les PLU (Plans locaux d'urbanisme) sans outils opérationnels. En gros, le problème est connu et laissé en l’état.
Si l’on résume, on a un désengagement financier qui limite la surveillance et les capacités d’action, des politiques environnementales stupides qui augmentent considérablement les risques en favorisant la multiplication des combustibles, et des politiques urbanistiques incohérentes qui augmentent les risques et les conséquences dramatiques. Bref, une combinaison de facteurs qui donne tous les ingrédients de la multiplication des « mégafeux » ces dernières années. Et on y retrouve toujours un seul et même acteur et responsable… non pas le réchauffement climatique, mais bien… le gouvernement d’Emmanuel Macron.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.